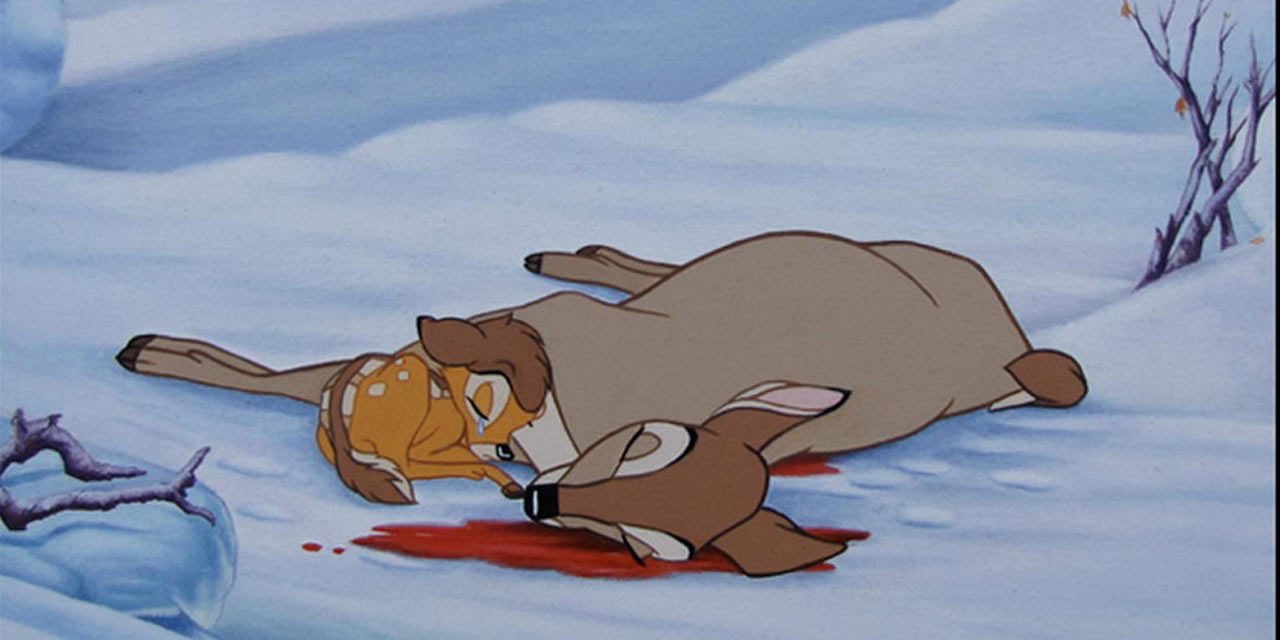HUMAINS ET ANIMAUX
De plus en plus de gens, dans les sociétés
occidentales, voient l’élevage seulement comme une étape préalable à un grand
massacre. On ne fait plus la relation entre l’élevage et l’alimentation, mais
entre l’élevage et la mort de l’animal.
Par extension, la consommation de viande
est criminalisée, et le consommateur culpabilisé.
L’éleveur est vu comme un monstre qu’on
soupçonne de prendre du plaisir à conduire ses animaux à l’abattoir.
C’est en quelque sorte une dérive de la
génération Disney, qui souffre profondément de ce que j’appelle le syndrome de
Bambi.
On s’apitoie et on pleure sur le sort des
animaux qui meurent, que ce soit par la faute des humains, ou pas.
Il me parait très sain de s’interroger sur
nos pratiques de superprédateurs et sur nos dérives de consommateurs et de pays
riches. Il est de plus en plus évident que les sociétés les plus riches
consomment trop de viande, créant un déséquilibre écologique potentiellement très
problématique. Par notre culture ancestrale, consommer de la viande est un
symbole de richesse, à tel point que lorsqu’une société pauvre accède à un
niveau de vie décent, son premier réflexe est de manger la viande fréquemment. De
la même manière, dans une société pauvre, la consommation de viande est
réservée à des situations de célébrations ou pour honorer un invité.
Mais il me parait aussi très abusif (et
même totalement décadent) de mettre sur le même plan la chasse au rhinocéros,
l’élevage des poulets en batterie, la corrida, la consommation modérée de
viande, la production de miel, l’utilisation des chevaux de trait en biodynamie
ou le massacre des bébés phoques.
L’être humain est physiologiquement
omnivore et la consommation de viande lui apporte un certain nombre d’éléments
nutritifs indispensables qu’on ne peut pas trouver dans les végétaux. Toutes
les tentatives pour substituer ces éléments pas des sources végétales ont été des
échecs, et même les compléments alimentaires à base de nutriments de synthèse n’ont
pas le même niveau d’assimilation.
Or nous en sommes là. Le véganisme reçoit
un accueil toujours plus grand et ses abus, proches du terrorisme, sont
regardés avec une certaine bienveillance par les gouvernements de tous bords.
Nos politiciens sont devenus de purs bureaucrates, beaucoup plus attentifs aux
enquêtes d’opinions qu’aux résultats scientifiques, et aux résultats réels des
décisions qu’ils prennent (on communique beaucoup sur les décisions prises, on
explique longuement ce qu’on en attend, et on laisse aux suivants le soin de
gérer les catastrophes collatérales qu’elles provoquent).
La science devient gênante lorsqu’elle ne
va pas dans le sens de la pensée politiquement correcte. C’est le cas pour la
consommation de viande, comme pour les néonicotinoïdes, le glyphosate ou les
OGM.
Nous sommes en pleine décadence médiatique,
sociale et politique. Le populisme est au pouvoir, mais pas l’habituel, le
vociférant, celui qu’on voit venir. Celui-ci est sournois et discret, pas de
discours enflammés, ni de boucs-émissaires évidents. Tout est dans la
manipulation de l’information, la parole est prioritairement donnée à
l’antiscience, à la peur.
C’est la fin de l’empire scientifique.
Cette décadence et ce refus de la science sont
très évidents dans la plupart des gouvernements européens et dans le
gouvernement des États-Unis, par exemple.
Début juin, le périodique français L’Express
publiait un article qui m’a interpelé, concernant la nouvelle loi française sur
l’agriculture et l’alimentation, sous forme d’une entrevue. Je ne reprends pas la
première question qui concerne la loi en elle-même, et n’intéresse que les
français. Ceux qui veulent lire cette partie peuvent cliquer sur le lien direct
vers l’article original.
En revanche, la plus grande partie de
l’article concerne la relation des humains avec les animaux, et me semble assez
fondamental.
Il s’agit d’une entrevue avec Jocelyne
Porcher, éleveuse, sociologue et chercheuse, aux parcours personnel et
professionnel assez particuliers.
Article original :
“Loi
alimentation: "Pas de progrès pour les animaux"
Par
Michel Feltin-Palas, publié le 02 juin 2018
« Comment une secrétaire parisienne se
retrouve-t-elle un beau jour à élever des poules, des brebis et des chèvres
dans la région toulousaine ? Au départ, Jocelyne Porcher est une néo-rurale
comme une autre, l'une de ces jeunes femmes désireuses de quitter la capitale,
son stress et sa pollution, pour se rapprocher de la nature. Elle saute le pas
dans les années 1980. La voici dans un village du Sud-Ouest, au contact de
paysans respectueux de leur terre. Elle est heureuse.
En
1990, c'est le choc. Elle vient de reprendre des études agricoles et se
retrouve dans une porcherie industrielle de Bretagne. Un autre monde :
"Moi, j'élevais des animaux car j'aimais leur compagnie. Je veillais à
leur bien-être, je m'occupais d'eux, je pensais à eux jour et nuit, j'entretenais
avec eux une vraie relation. En Bretagne, ils étaient perçus comme de simples
objets, des ressources destinées à produire de la matière animale. Ils étaient
frappés, mutilés, insultés. Avec pour une seule finalité : l'argent."
De
cette double expérience, elle tire une conviction : les élevages traditionnel
et capitaliste sont deux univers que tout oppose, dans leurs pratiques comme
dans leurs valeurs. Et elle refuse que le premier, où l'homme vit en symbiose
avec ses bêtes, soit balayé par les excès du second. Elle se lance alors dans
la recherche, se spécialise dans les relations affectives entre les hommes et
les animaux, passe une thèse, est embauchée à l'Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), publie des livres (1). Un parcours qui lui permet
aujourd'hui de dénoncer tout à la fois les dérives de l'agro-industrie et les
ultras de la cause animale. Entretien. »
[…]
« Le
gouvernement met en avant le doublement des peines pour délit de maltraitance
animale et la formation au bien-être animal dans les lycées agricoles. Cela ne
va-t-il pas dans le bon sens ?
Tout
texte de loi comprend évidemment quelques mesures positives, mais cela reste
une goutte d'eau dans un océan de violence. Pour ma part, il n'y a qu'un
article que j'approuve vraiment : c'est l'autorisation d'expérimenter
l'abattage mobile, une idée que je défends depuis longtemps avec mon
association Quand l'abattoir vient à la ferme.
Quels
seraient les avantages d'une telle solution ?
Aujourd'hui,
les animaux sont poussés de force dans un camion qui les emmène dans un lieu
inconnu pour être tués en masse par des hommes qu'ils n'ont jamais vus. L'abattage
à la ferme évite ces dérives. C'est un progrès pour les éleveurs, qui peuvent
veiller sur leurs animaux de la naissance à la mort ; un progrès pour le
consommateur à qui l'on garantit une parfaite traçabilité, et un progrès pour
le bétail, à qui l'on évite tout stress et toute souffrance.
Toute
souffrance, vraiment ?
Oui,
dans la mesure où les bêtes sont étourdies et inconscientes au moment où elles
sont saignées. Il n'y a ni souffrance physique ni souffrance mentale.
Curieusement,
vous êtes très critique vis-à-vis de l'association L 214, qui contribue elle
aussi à dénoncer les conditions d'abattage de l'abattage industriel.
Nous
divergeons sur les finalités de l'action. L 214 est abolitionniste : elle
milite pour une agriculture sans élevage et une rupture des liens de
domestication. Pour ma part, je considère que la domestication est non
seulement nécessaire pour l'homme, mais que les animaux de ferme et ceux dits
de compagnie y ont eux aussi intérêt.
Comment
cela ?
C'est
très simple à comprendre : dans la nature, beaucoup d'animaux auraient une
espérance de vie très courte s'ils n'étaient pas défendus par l'homme. Une
brebis ou une chèvre isolée dans une montagne devient automatiquement une proie
! Et la vie d'un mouflon dans un territoire où rodent les loups est dominée par
l'anxiété. C'est pourquoi, à la période néolithique, voilà environ 10 000 ans,
des relations de domestication se sont créées, avec l'accord des espèces
concernées. L'homme et la chèvre, l'homme et la vache, l'homme et le cochon,
ont noué une alliance et compris qu'ils avaient un intérêt réciproque à vivre
ensemble, par un système de dons et de contre-dons.
N'est-ce
pas une vision un peu idyllique ? Quand l'homme prend la laine, le lait et la
viande d'une brebis, que lui apporte-t-il en échange ?
La
nourriture et la protection. Mais il faut aller plus loin. Cette relation ne se
réduit pas à des questions d'intérêts : elle va bien au-delà. En réalité,
l'homme a toujours eu besoin de la compagnie des animaux. C'était vrai au temps
du néolithique et cela n'a pas changé. C'est pour cela que les éleveurs
d'aujourd'hui sont souvent de jeunes urbains qui choisissent ce métier. Et
qu'autant de Français possèdent des chats et des chiens.
Il
y a tout de même une grande différence entre les animaux de ferme et les
animaux de compagnie : on tue les vaches et les cochons, pas son chat ni son
chien !
Pourquoi
le feraient-ils ? Ils n'ont aucune raison d'agir ainsi dans la mesure où ils
gagnent leur vie autrement. Mais mettez-vous à la place d'un berger qui passe
toutes ses journées à s'occuper d'un troupeau de vaches. Il faut bien qu'il
vende de temps en temps le lait ou la viande de ses bêtes pour se procurer des
revenus.
Vous
présentez la situation comme une "alliance" entre l'homme et les
animaux. Mais les animaux sont forcés de travailler pour nous.
Mais
le travail n'est pas forcément une aliénation. On sait depuis longtemps à quel
point il est central dans l'existence humaine. J'ai montré avec mon équipe
qu'il peut l'être aussi pour les animaux.
Réellement
?
Observez
un chien d'aveugle ou un chien de berger : ne voyez-vous pas à quel point il
est heureux de travailler ? Il en va de même pour un cheval ou une vache : tous
ces animaux s'investissent dans le travail qui leur est demandé, cherchent à
comprendre les exigences de leur maître et, quand ils y parviennent, en tirent
une réelle satisfaction.
Les
"antispécistes", qui réfutent la supériorité de l'homme sur l'animal,
estiment que nous avons pour devoir de changer notre alimentation et de libérer
les animaux.
Ils
se trompent ! Allez voir les brebis qui vivent entourées de loups dans les
Alpes et demandez-vous si elles veulent être "libérées". Ceux qui
tiennent ce discours vivent souvent en ville et ont de la nature une image
idéalisée et déconnectée des réalités. Ils cherchent en fait à se libérer d'un
poids moral et de la culpabilité qu'ils ressentent à voir l'espèce humaine
élever et tuer des animaux. Mieux vaut chercher à comprendre ce qui nous relie
aux animaux, à améliorer leurs conditions de vie et de mort, plutôt que de se
débarrasser du problème, d'autant que l'on ne ferait qu'en créer un autre,
encore plus grave.
Lequel
?
Si
l'humanité cesse d'élever des animaux domestiques, elle ne cessera pas pour
autant de manger de la viande. Donc, elle passera à la viande in vitro,
produite à partir de cellules. Tandis que les chiens et les chats, que nous
nous sommes soi-disant honteusement appropriés, devront être
"libérés" et remplacés par des robots. Ne vous leurrez pas : cela
équivaut à un changement historique de paradigme anthropologique. Après avoir
vécu avec les animaux domestiques pendant 10 000 ans, l'homme devrait rompre
avec eux pour construire à une humanité basée sur l'intelligence artificielle
et les biotechnologies alimentaires. C'est sans doute passionnant d'un point de
vue intellectuel, mais, de mon point de vue, c'est une perspective effrayante
pour notre devenir humain, ou plutôt inhumain. »
(1) Notamment « Vivre avec les animaux,
une utopie pour le XXIème siècle » (La Découverte, 2014).